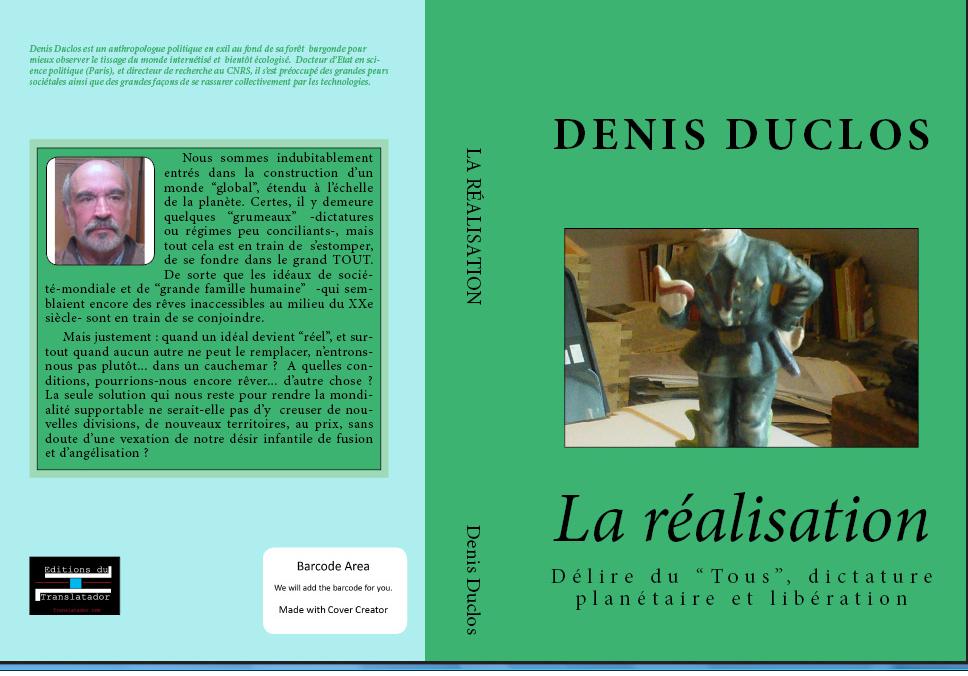(vous pouvez consulter les 40 premières pages ci-dessous)
Le « totalisme » actuel, en perspective
d’une histoire humaine de la métaphore
Jadis, au temps où Grecs et Juifs se fondaient dans l’empire-monde romain, émergea un rêve, un rêve pour tous : rêve d’un royaume universel fondé sur l’Esprit et non sur la vulgaire matière vivante, grouillante et mortelle.
Puis l’empire mourut mais le rêve persista. L’Esprit Saint, le Paraclet -l’intercesseur-, devint Science, et celle-ci permit d’accroître la puissance. Bâtir le royaume divin devenait enfin possible pour peu que les turbulents Humains acceptassent de se couler dans le moule spirituel qui donnait enfin sens à leur œuvre : accomplir la volonté du vrai Dieu.
Le livre que l’on va lire traite d’une réalisation à la fois évidente et mal perceptible : nous vivons dans une société-monde en formation, qui, par surpuissance technique et absence d’extériorité, tend, physiquement, à instituer le régime d’un totalisme auprès duquel les totalitarismes du XXe siècle apparaissent comme des « brouillons ».
Ce totalisme est, au nom du bien commun et d’un monde meilleur, en train de gagner la planète à partir de sa partie « développée », tel un tsunami gigantesque, et pourtant presque insensible pour ceux qui y sont submergés. Il ne provient pas d’un groupe de gens mal intentionnés ni ne conduit au culte de la personnalité de dictateurs. Il ne fonctionne pas par la peur et le diktat assignable à un tyran visible ou à une classe de « maîtres du monde », bien que celle-ci en soit un marqueur certain.
Bien au contraire, il suinte, déborde et déferle à partir de « nos cœurs » , de nos bonnes intentions démocrates, de notre tolérance « bobo », de notre idéal libéral, et ce n’est pas un hasard si son vecteur le plus efficace a été, et reste l’idéologie individualiste et libertarienne en vigueur aux Etats-Unis, puissance chrétienne encore triomphante de l’époque.
On n’en trouvera pas le germe maléfique dans une époque, un auteur, un régime, une classe : il s’est déployé à partir de multiples sources, aussi antagoniques que les monachismes et les féodalismes, les mercantilismes impériaux, les capitalismes et les communalismes. Il serait vain d’en rechercher les origines, pour autant, qu’en fin de compte, il faudrait remonter à la naissance de la parole pour en trouver l’impulsion primaire : celle de la volonté de rêver « l’être ensemble !»
Néanmoins, le totalisme du XXIe siècle présente, pour la première fois de façon irréfutable, un processus imputable à la masse humaine en tant que telle. Au « nous tous ». Et c’est en cela qu’il est fascinant et terrible, désignant du même coup le lieu d’une monstruosité, jusqu’ici toujours imputable à tel ou tel bouc émissaire, à tel délirant partisan forcené de l’Ordre.
En ce sens, ce phénomène est intéressant pour l’anthro-pologue -même atterré ou terrifié- parce qu’il met en évidence quelque chose d’essentiel et qui a toujours été caché, de par la puissance de refoulement imparable du sujet collectif et de ses avatars corporatifs. Tenu aussi à l’arrière-plan par la multiplicité des cultures humaines et leurs contradictions.
Et dans le même sens, le totalisme mondial se répandant au XXIe siècle est, au-delà de son propre symptôme, un témoin, une borne, un trait, permettant a contrario d’évoquer ce qui, en l’Humain également, serait réellement capable de s’opposer à cette tendance sans faire bégayer l’histoire, sans retour en arrière.
C’est, nous allons le voir, en définissant précisément le totalisme comme une quête incoercible de la culture parolière et langagière humaine, et en analysant ses effets circonstanciés en mondialité approfondie, que nous pouvons, peut-être pour la première fois dans notre errance historique, proposer un mode d’intelligence et d’action collective qui ne retombe pas, inexorablement, dans le fantasme du pouvoir absolu (sous sa forme verticale ou latérale), lequel a fini par corrompre jusqu’ici toutes les tentatives innovantes ou révolutionnaires, et surtout celles qui avaient triomphé de leurs adversaires.
Le fantasme d’un superpouvoir mondial nourri des espoirs de toute-puissance technologique, a été extraordinairement bien décrit par l’un des grands génies du XXe siècle, Philip K. Dick . Mais ce merveilleux prophète, qui a anticipé les évolutions actuellement produites pour donner à une hyper-élite les moyens de contrôler complètement l’espèce humaine, a péché par désespoir : croyant connaître le fond des âmes, il n’entrevoyait comme solution qu’une aide venue d’ailleurs, celle d’un extra-terrestre bienveillant ou un Dieu caché.
Or, si l’installation -aussi rapide que possible- d’un Etat Universel gérant des populations asservies par leur propre fascination envers la technologie rédemptrice n’est pas une menace illusoire (elle se confirme davantage de décennie en décennie), une anthropologie attentive peut déceler certains signes d’un changement plausible d’orientation et de destinée. Elle peut aussi -ce qui est plus rare- en rendre compte dans ses causes et dans ses effets.
Il ne s’agit pas ici d’apporter la pénultième «bonne nouvelle » ou l’évangile pour notre temps, de répéter l’hallu-cination salvatrice qui fait retour dès que le degré de défiance envers nous-mêmes atteint l’insupportable.
Il est plutôt question de revisiter avec plus de rigueur et de précision les mécanismes qui semblent organiser le devenir collectif humain selon une apparente fatalité. Celle-là même qui paraît faire retour -comme un inexorable Réel de l’Humain- malgré tous nos soubresauts, toutes nos panacées, tous nos efforts de conjuration, de contournement, de progrès, de redressement, de repentir.
Nous préférons une approche indéfectiblement patiente, et peut-être en un sens héroïque, qui soit capable -sans se soustraire pour autant aux légitimes inquiétudes qui agitent au présent la multitude de nos congénères- de mettre à l’épreuve tous nos outils d’observation et de compréhension, nos concepts, nos cadres d’analyse, nos instruments de mesure, de retourner sans relâche aux terrains pour piéger la trace parfois infime et fugitive d’un trait essentiel mais qui nous aurait échappé.
Cet effort est d’autant moins inutile que nous savons par ailleurs la force énorme déployée en permanence par les idéologies -dont on a pu ridiculement annoncer la mort au nom d’autres idéologies-, ces nébulosités de l’esprit ne dépendant d’ailleurs pas des stratégies conscientes ou assignables à des acteurs, ni même à des classes d’intérêts reconnaissables.
Ce travail n’est évidemment pas aisé, car les voiles idéo-logiques nous enveloppent tous, ne serait-ce que parce que nous devons bien partir de termes reçus pour penser, au risque de dériver dans leurs bulles de sens, et cela durant toute notre vie consciente et inconsciente.
On se souvient que c’est le refus de cette dérive qui autorisa Descartes à décréter une fondation : le constat de sa propre pensée. Hélas, nous sommes désormais avertis que même et surtout cette évidence conduit directement à l’erreur -celle-là même qui alimente l’hallucination technochrématistique si répandue aujourd’hui-. Car notre pensée ne nous appartient pas, ou si peu : elle ne réside pas comme le pensait René dans la glande pinéale (comme siège de l’âme et du sensus communis), mais… dans l’ensemble des liens sociaux qui ont suscité et réglé la parole. Il nous faut donc aller plus loin que « le cavalier qui partit d’un si bon pas », et retourner au plus près de la chose même : le fonctionnement de la société humaine.
Il est inutile de faire davantage attendre le lecteur pour tracer le cadre d’explication qui sera utilisé ici et confronté à la description de « ce qui nous arrive » dans une actualité bousculée, accélérée, déferlante.
Bien sûr, nous ne comptons pas emporter d’emblée sa conviction, qui résultera justement de la mise en acte du cadre d’analyse avec la diversité et la complexité des conjonctures détaillées. Mais il disposera au moins d’un premier fil conducteur, et nous éviterons l’impolitesse d’une promesse indéfiniment suspendue -acceptable pour un roman, mais pas pour un essai de théorie politique-.
Voici donc, en quelques paragraphes, le condensé que nous espérons le plus clair possible de notre démarche :
La tendance irréfutable des Humains à favoriser le plus grand pouvoir, la plus grande puissance à la fois individuelle et collective n’est pas explicable essentiellement par un trait « naturel » de l’espèce, par un caractère génétique extérieur et préalable à la culture et à sa constante représentée par les actes de parole. La thèse d’une espèce de primates particulièrement agressive et prédatrice par son corps et ses techniques ne tient pas . C’est principalement la culture qui pousse notre espèce à des excès pathétiques dans toutes les directions, et finalement dans celui d’une condensation massive du pouvoir collectif sur les personnes et les groupes.
Ce fait, assez reconnu bien qu’encore contesté, n’est le plus souvent pas compris. Or, ce dont il faut rendre compte, c’est de l’énergie incroyable qui nous anime, en gros, depuis 70 000 ans, c’est-à-dire depuis que nos ancêtres -déjà anatomiquement « sapiens » depuis un million d’années- se sont mis à la fois à parler et à générer un foisonnement d’inventions culturelles et techniques. Ce point de départ « déflagrant », plausiblement assez localisé dans le temps et l’espace, est admis par une grande majorité d’anthropologues, de linguistes, de préhistoriens, d’archéologues, etc. Mais il n’est toujours pas expliqué.
Pointons tout-de-suite le centre et la limite de notre propos : il n’est pas question, ici, de répéter des expériences en pensée -réalisées dans d’autres ouvrages- concernant les origines du démarrage culturel de l’humanité actuelle. Il est plutôt d’utiliser le résultat des hypothèses les plus probantes pour décrire d’une façon renouvelée les événements vécus aujourd’hui, au débouché d’une histoire mouvementée, et néanmoins assez ordonnée vers l’universalisation , fait qui, à son tour, n’apparaît indubitable qu’aux générations présentes qui en sont les protagonistes directs.
L’hypothèse la plus importante concerne la « constante culturelle » agissant en nous depuis quelques dizaines de milliers d’années, laquelle nous permet de reconnaître l’intentionnalité des auteurs des peintures de Lascaux, par exemple, même si les intentions précises de ces œuvres peuvent nous être encore obscures. Nous savons, de manière immédiate et sûre, que ces auteurs étaient déjà « nos frères » en culture : ils signifiaient, représentaient, symbolisaient tout comme nous, et tout comme s’ils nous parlaient, même si leurs codes n’étaient pas les nôtres, tout comme ceux d’une langue étrangère ne nous sont pas donnés d’office.
L’humanité, déjà sociale, n’était probablement pas très grégaire en tant qu’espèce de primates, mais elle l’est devenue en tant que parlante, simplement parce que la parole unit tout le monde autour des mêmes symboles, ou plutôt de leur difficulté assumée, impuissance réciproquement tolérée dans ce qu’il faut bien appeler « reconnaissance intersubjective ».
Il y a donc les meilleures raisons de penser que c’est cette tendance à constituer la communauté culturelle sur une valeur inassignable et incalculable de chaque interlocuteur (traversant l’humanité depuis ces commencements culturels spécifiques) qui contient le secret d’une poussée ininterrompue jusqu’à l’état présent d’interconnectivité généralisée au niveau planétaire .
Bien sûr, les symboles dérivant et se divisant selon les peuples, l’unité a toujours été une lutte, parfois féroce, et au prix de massacres, mais il ne faut pas perdre de vue que c’est toujours son enjeu qui a été -est encore- au cœur des conflits les plus sanglants.
On peut néanmoins se poser la question de savoir pourquoi cet enjeu a toujours semblé crucial, même quand l’on pouvait se contenter de la paix entre Etats suffisamment forts. Pourquoi l’énergie d’un désir d’unification supérieure a toujours travaillé les situations les plus apparemment stables et « heureuses».
Là encore, la réponse repose, semble-t-il, dans la pratique la plus banale et la plus quotidienne de la parole, ce trait universel de l’humanité (et seulement d’elle, même si d’autres espèces disposent de « langages »). Car toute parole valide comme acte est un phénomène fondamentalement paradoxal -et pour cela déstabilisant- : elle implique que chaque parlant soit à la fois totalement obéissant et totalement libre.
Pour parler, il faut en effet adhérer « librement » à la communauté d’échange dans laquelle la parole de chacun doit « compter », et en même temps se contraindre à utiliser les systèmes symboliques en vigueur avec le minimum d’erreurs ou de divergences par rapport aux codes reçus (sous peine d’être dits criminels ou fous).
En quoi cette réalité, évidente dès qu’énoncée entraîne-t-elle automatiquement un paradoxe dont les effets massifs n’ont pu être évités par personne ? Là encore, la réponse est si simple qu’on a tendance à ne pas l’entendre : être contraint d’être libre, mais libre… de se contraindre introduit chez chaque sujet-assujetti une équivoque, un balancement, une contrariété interne qui ne trouve jamais de solution pleinement satisfaisante. Nous ne sommes jamais « contents », parce que le système oscille toujours soit du côté d’un « trop » de contrainte asservissant les sujets parlants, soit du côté, au contraire, d’une « anomie » qui est certes libératrice, mais risque d’opprimer du même coup les autres participants ou de dissocier les liens sociaux les plus vitaux.
Nous cherchons donc -dès l’origine de la culture parlée-des solutions à ces dilemmes, mais aucune ne les résolvent, puisqu’elles reproduisent nécessairement -en parlant- les déséquilibres, voire les amplifient en les déplaçant.
Il n’est pas étonnant que certains types de solutions soient préférés de façon récurrente à d’autres, parce qu’ils paraissent plus à même de résoudre le paradoxe primordial. Il s’agit notamment des propositions qu’on dirait aujourd’hui « win-win », à savoir favorables à toutes les parties.
Ainsi, comme l’aperçut jadis la pensée utilitariste, l’augmentation générale de la puissance d’une société peut sembler favorable aussi bien à ceux qui, la dirigeant, vont disposer d’encore plus de pouvoir, qu’à ceux qui, faibles ou pauvres, vont tout de même bénéficier de « miettes » supplémentaires.
Bien entendu, certains participants ne sont pas longs à s’apercevoir qu’il y a là « marché de dupes », car, dans la puissance augmentée du Tout, chacun dispose d’une part nécessairement plus petite en termes relatifs. Or, dans un groupe où la part relative de chacun représente le degré de respect qu’il reçoit des autres, on peut concevoir qu’un renforcement -même bien réparti- de la puissance collective, revient à humilier chacun des participants.
Exemple : dans l’hypothèse où nous devrions voter pour un gouvernement mondial, nous pourrions avoir l’impres-sion qu’être chacun un sept-milliardième d’humanité n’est vraiment pas grand-chose et que la « démocratie mondiale » n’est qu’une moquerie envers chaque être humain qui, pourtant, la compose égalitairement.
Pour autant, la « solution » démocratique paraît encore celle qui mécontente le moins puisque toutes les autres reviennent à officialiser une inégalité de droit. Faut-il pour autant s’y tenir sans analyse critique ? Ne voit-on pas que pour ceux qui sont sensibles à cette réduction de leur valeur personnelle à une chiffre infinitésimal -autant dire rien- l’humiliation peut conduire à un fort désir de sécession, ou bien encore à une résignation qui, du même coup, retire toute sincérité et toute véracité à la fiction de leur « participation » comme sujets de la parole (politique en l’occurrence) ?
Ce raisonnement ne tient que si nous acceptons le fait que les Humains sont des Parlants, et que ces derniers ont ceci de différent des Communicants (lesquels peuvent être des robots) qu’ils se transmettent à chaque instant, dans chaque acte de parole, l’incertitude sur le fait que leur interlocuteur reconnaît ou non (ou plus ou moins) leur souveraineté comme participant à la parole !
Or, dans un monde de Parlants où notre réalité de « per-sonne physique » n’est perçue et reconnue que par l’intermédiaire de nominations et des métaphores qui les soutiennent, cette incertitude inévitable est cruelle, voire insupportable. Tout ce passe comme si le régime de la parole nous obligeait constamment à « être reconnus », et, du même coup, à reconnaître autrui en échange, cette reconnaissance ne pouvant jamais se réduire à celle d’une fonction, d’une place, d’une chose, mais impliquant toujours, au travers de celles-ci, l’engagement à reconnaître le sujet humain souverain -et inassignable a priori à son support physique- en autrui comme en moi-même.
L’autre nom de cet engagement dans la reconnaissance mutuelle d’un caractère ineffable et irréductible, trait essentiel inhérent au « speech act », c’est la confiance.
Certains philosophes en vogue nous le rappellent : nous ne pouvons exister dans le monde des paroles sans confiance mutuelle. Et de grands entrepreneurs de mettre aussitôt le mot « confiance » sur leurs publicités, ce qui me rappelle un peu la foule des disciples de Bryan (Jésus interprété par les Monty Python) répondant d’une seule voix éperdue de soumission : « Soyons libres ! » à l’appel désespéré de Bryan pour les congédier… Ce constat, donc, ne suffit pas : il faut encore admettre qu’il est fondé sur le fait culturel indestructible (tant que l’on continue à parler) d’une fiction obligatoire de liberté du sujet parlant.
C’est la raison pour laquelle un contrat implicite ou explicite validant l’obligation de laisser des cookies sur son ordinateur personnel, (sous prétexte qu’il s’échange avec la gratuité de la prestation de moteur de recherche) ne peut pas fonctionner sur le long terme : il est « illégal » au regard de la loi symbolique fondant tout échange de parole, et selon laquelle je dois être absolument libre de parler ou de ne pas parler, si je veux -comme tout locuteur- que ma parole soit considérée comme valide.
Or toute « écoute », tout enregistrement de ma parole -voire de mon image- par un tiers ont deux effets immédiats : ils font entrer en conversation ce tiers qui devient interlocuteur, mais interlocuteur indélicat puisqu’il n’est là que pour instrumentaliser ma parole et mon image comme informations, et ceci non pas au nom d’un alter ego, mais à celui d’un collectif surpuissant par assemblage de forces.
Tout anthropologue un peu compétent (même s’il n’a pas lu Habermas) est en mesure d’affirmer que cette rupture dans le lien de parole va nécessairement entraîner du ressentiment, des troubles, des conflits. Tenter de les régler par des manipulations supplémentaires ne fera qu’aggraver le problème et la seule question devient alors : combien de temps se passera-t-il avant que la révolte des locuteurs humiliés finisse par contraindre le locuteur abusif de revenir à la situation « de félicité » seule apte à consolider et valider l’acte de parole ?
C’est exactement sur ce point que nous sommes peut-être en désaccord avec Aldous Huxley, Georges Orwell, Philip K.Dick ou Terry Gilliam (dans Brazil), voire… Michel Foucault ou Pierre Bourdieu : ces grands auteurs -et bien d’autres dans divers genres- ont en effet en commun de nous amener à croire que la lutte de personnes et de groupes pour le pouvoir absolu peut parvenir à des états métastables de longue durée, au cours desquels il devient pratiquement impossible de réagir. Ce pessimisme est d’ailleurs l’un des ressorts les plus efficaces de la science-fiction critique, prolongeant en quelque sorte la science-fiction tout court, celle dont Jacques Lacan disait que c’était la vraie science, celle qui nous fait courir, précisément dans le sens du triomphe absolu sur autrui !
Le désaccord porte, néanmoins, sur des détails : ce n’est pas l’incroyable ténacité du désir de pouvoir sur autrui qui est ici en cause, mais sa limite et surtout la nature précise des difficultés et des antinomies qui le traversent.
Ces détails, pourtant, sont d’une grande importance, car de leur appréciation fausse ou juste peut découler une différence considérable dans l’évaluation des situations actuelles et les chances de les faire changer par l’implication dans un mouvement.
Ce qu’il faut parvenir à comprendre d’un seul tenant, c’est à la fois l’insatiable appétence pour le pouvoir absolu -quitte à le subir !- et le goût tout aussi fort pour la liberté.
La réponse à cette énigme, déjà explorée jusque à un certain point par Elias Canetti dans son grand-œuvre sur la Masse , tient au fait que… c’est la même chose retournée en son contraire.
Pourquoi ? Comment ? Il ne s’agit pas de magie noire : le mécanisme en est excessivement simple et logique. Il suffit pour le reconnaître de constater que la liberté de chacun, parce qu’elle peut être menacée par la force d’une majorité, ne doit sa subsistance qu’au fait de s’associer à celle d’autres semblables, afin de devenir à son tour puissance majoritaire… au prix de menacer à son tour la liberté des antagoniques.
Le caractère épidémique et propagatif de cette réalité a été maintes fois observé, par exemple dans le phénomène de l’angoisse : plus vous anticipez que l’adversaire va venir opprimer votre liberté, et plus vous vous hâtez de former une milice apte à le prendre à revers. Ainsi, la seule concurrence pour la liberté vous contraint-elle à produire les armées visant à restreindre celle d’autrui pour augmenter ou préserver la vôtre. Celui qui refuse d’entrer dans cette logique de propagation au nom de principes moraux est vite -et à juste titre- traité d’idiot, puisque de fait, s’il ne participe pas à la contrainte mutuelle visant à construire la force de répression de l’adversaire potentiel, il se trouvera d’autant plus vite réduit à l’esclavage.
Dès lors que fonctionne l’anticipation des actes d’autrui, la réaction en chaîne semble irrésistible, et nous sommes bien en présence d’un effet incontournable de la liberté en tant que paradoxe, voire d’antinomie radicale : elle produit inéluctablement son contraire.
Il existe cependant un vice dans ce raisonnement imparable : à savoir que la liberté dont il s’agit dans la parole n’existe pas en dehors d’elle. Contrairement au modèle précédent, la liberté d’autrui est la condition même de la mienne, puisque c’est de sa liberté de me reconnaître que je la tiens, et réciproquement. Plus je tente de l’asservir pour qu’il ne me « nuise » pas, et moins je trouve en lui un interlocuteur qui valide ma propre liberté. J’interromps donc du même coup le processus de la parole, pourtant seule base pour constituer le concept même de liberté
. Non seulement, comme l’ont observé les philosophes, je ne me libère pas moi-même en devenant « maître », mais l’esclave en qui j’ai transformé mon ancien alter ego ne peut plus, même s’il le voulait, me considérer comme un homme libre : il m’oblige constamment à n’exister pour lui que comme maître asservi au rôle de geôlier, de persécuteur, de contrôleur, etc. Je suis assujetti au personnage encombré d’instruments d’oppression. Tout mon monde devient celui d’un gardien de camp ou de prison, d’un exécuteur. J’ai beau m’en extraire chaque jour pour prétendre vivre par ailleurs ma vie de « bon père de famille », la vérité de ma condition me hante et me rabaisse constamment au niveau de déréliction de ma victime. Et si elle accumule les souffrances, je suis accaparé par le maintien et l’activité des instruments produisant la souffrance. Je suis avili comme tortionnaire par l’avilissement du supplicié.
Dès-lors, le plaisir que je peux aussi ressentir du fait que je ne suis pas la victime, la suavité du sentiment d’être victorieux et « survivant » (comme le notait Canetti) grâce à la puissance collective de la masse dont je suis membre, se trouve pour ainsi dire vidé de substance par l’affai-blissement et la disparition même de l’ennemi. Je dois alors compenser ce « vidage » par des drogues dont l’illusion est consacrée à le nier.
La durée d’un régime fondé sur une maîtrise élitaire est donc directement fonction de celle de l’acceptabilité pour les maîtres de l’illusion compensatrice de leur propre vidage subjectif. Si nous parvenions à théoriser cette question de façon réaliste et convaincante, nous serions en mesure de prédire le moment et la forme du « renversement de valeurs » qui inaugure le retour à la situation de parole, et donc de reconnaissance mutuelle de la souveraineté des sujets en conversation, reconnaissance qui n’a rien à voir avec la comparabilité ou la commensurabilité .
Le problème fondamental de la parole est qu’elle est née et s’est déployée comme acte d’unification du groupe de parlants, c’est-à-dire en opposition à ceux qui ne parlent pas, ou qui parlent une autre langue. Ce qui signifie que l’amitié instaure d’emblée, par la simple performance d’un engagement libre de soi dans la convention, son envers : l’inimitié de principe envers ceux qui ne procèdent pas à cet engagement mutuel incarné dans le simple fait de « se parler », et a priori indépendamment des contenus de la parole (des « dire », des « discours »).
Pourquoi est-ce un problème ? Parce que cette inimitié extérieure au groupe est toujours en instance de s’infiltrer dans le groupe : la liberté d’adhérer est toujours aussi celle de trahir. L’ami le plus intime peut à tout moment se transformer en ennemi, comme dans le mythe shakespearien de McBeth. L’extériorité « infecte » l’intériorité partagée par le miracle de la parole.
Cette ambiguïté ou fragilité de la communauté de parole est amplifiée par un autre caractère primordial : le fait que le « dire », le contenu de ce que l’on dit en se parlant est essentiellement une comparaison, c’est-à-dire une proposition à but de conviction. Or de quoi tente-t-on de convaincre celui avec qui l’on parle, quel que soit le procédé rhétorique utilisé pour ce faire ? Au-delà de la diversité infinie des objets concrets mis en discussion, il s’agit toujours de la même « chose » (causa) : on cherche à convaincre l’autre (et soi-même par la même occasion) de valider la situation même que l’on est en train de vivre, à savoir la communauté de parole, celle-ci devant toujours être affirmée contre l’existence de formes de solidarité concurrentes soit étrangères, soit « inférieures ».
Or, en admettant que le monde extérieur soit aisément perçu comme hostile ou potentiellement dangereux, il n’en vient pas de même des groupes d’intimité plus restreints et plus « naturels » dont l’union est attendue pour former l’unité langagière.
Autrement dit, la comparaison, la métaphore première qui a pour but de construire en permanence l’entité commune idéale, au travers même de l’acte performatif en train de se dérouler entre deux parlants « amicaux » (ou, à la limite, sincères et francs), s’érige toujours en laissant planer un doute sur la loyauté d’un membre qui, par ailleurs, « appartient » à un groupe de solidarité plus intime. Du même coup, ce petit groupe « familier » est suspecté de résister à son propre englobement dans l’entité de solidarité « de parole ». En général, toute double appartenance est un jour ou l’autre tenue pour suspecte (du « juif-allemand » au « binational »), mais l’origine de cette suspicion est l’objet éternel que représente le lien parental ou/et sexuel. On dira même, en reprenant une expérience finalement assez solide de la psychanalyse, que c’est « le Père » qui, situé hors de la frontière du ventre matriciel, constitue le suspect originel et constant.
Nous pouvons en conclure qu’à tout moment une com-paraison peut s’établir entre le familier du membre et l’étranger, de sorte que la trahison est un thème qui se juxtapose automatiquement à celui du souci de convaincre ledit membre d’adhérer toujours plus pleinement à sa « nouvelle famille » qu’est la communauté langagière.
Inversement, le phénomène jouant dans les deux sens, l’étranger peut aussi devenir l’objet d’un « sentiment tendre » (notamment dans les cas où l’exogamie est de règle), de sorte que le pardon peut aussi atteindre la trahison (et l’éteindre comme telle).
Il est alors loisible d’admettre que cette amodiation d’un principe tranché (« être » ou « ne pas être »… un membre reconnu du collectif) prenne la forme de la quantité plutôt que de la qualité. La quantité permet en effet de distinguer, hors du Tout ou Rien, des niveaux de tolérabilité d’une infraction au pacte implicite entre tous les Parlants. Elle permet de constituer des échelles plus ou moins précises, dotées de « seuils », de « lignes rouges » à partir desquels la réaction de rejet devient de plus en plus prévisible à mesure que l’on s’en approche. Encore que, comme l’entrevit Zénon d’Elée, le fait de pouvoir toujours diviser par deux la distance parcourue par une approche peut, de fait, rendre inatteignable la ligne en question. C’est une façon de se représenter -pour une société de commerçants notamment- l’élasticité des principes !
Cependant, un autre effet de la traduction en quantité d’une distinction autrement incommensurable, se situe à l’opposé : la confrontation à l’inélasticité absolue.
En effet, dans un groupe de parole où la quantité a remplacé la qualité comme critère d’appartenance, deux conséquences radicalement contraires sont attendues en même temps : d’une part, les relations sont adoucies (praos) par des concessions mutuelles permanentes, lesquelles tendent finalement à un échange « équitable », voire « égal », mais d’autre part, le principe de reconnaissance en soi et en l’autre d’un sujet pleinement souverain et libre persiste en arrière-plan. De sorte que, lorsque vous recevez votre « dû » en termes quantitatifs, celui-ci demeure toujours insuffisant au regard du principe de pure liberté : vous avez été « acheté », et même si l’autre de la relation a été doté du même cadeau, vous ne valez tout de même qu’une moitié « d’être », pour autant que l’être ne se partage pas .
Ceci explique la scène banale des enfants, frères et sœurs, qui continuent à se bagarrer alors qu’ils ont eu droit à une parfaite égalité de partage. Et cela explique aussi qu’une personne en situation de se croire « supérieur » par la quantité d’attributs qu’on lui accorde, en voudra toujours davantage, non seulement jusqu’à ce que l’autre n’ait plus rien (comme dans la fable du Mahabharata), mais qu’il ait été anéanti en personne. Cette apparente (et réelle) folie tient à la rencontre logique impossible, insoluble, entre un principe absolu (être un sujet libre) et sa médiation (marchander la liberté).
C’est ici qu’intervient le concept de « destinée de la métaphore », laquelle ne se conçoit que comme destinée d’une conversation où la métaphore principale véhiculée et échangée par les interlocuteurs est amenée à évoluer, se transformer, et, finalement aboutir à une sorte d’impasse logique d’où nous cherchons à tout prix (et même désespérément) à sortir, ce qui est le moment à la fois le plus tragique et le plus fécond des histoires humaines.
Pourquoi et comment cette « destinée » de la parole intervient-elle inéluctablement ? Il existe plusieurs façons de présenter ce mouvement récurrent, mais en cherchant à rester au plus près de notre cadre théorique, il est possible de recourir à l’articulation d’énoncés suivant :
D’abord, il nous faut postuler qu’il n’existe aucune parole solitaire, isolable d’une « dialogique », laquelle se déroule aussi dans l’ensemble de la communauté de parole qui sert, pour ainsi dire, de toile de fond, ou mieux de « témoin collectif » à chaque conversation particulière (comme le chœur antique).
Ensuite, nous devons admettre que ladite conversation est un « procès » (au sens oublié de « processus »), au cours duquel les propositions engagées au départ (à « l’ouverture ») dans l’interlocution se modifient pour parvenir à une « clôture », une décision tranchant sur leur signification et leur emploi. En ce sens, tout processus de parole conversationnel (y compris avec soi-même) tend à ressembler à un « procès » au sens juridique du terme, au sens d’une réduction progressive des ambigüités et des désaccords, puis d’une décision finale éliminant les résidus « parasites » (ou devenus tels).
Cette historialité de toute conversation, de tout échange de paroles, présente un aspect tragique. En effet, l’élimination de sources de désaccord ou d’ambigüité a pour conséquence d’arrêter la pratique de la parole et d’opérer une « réalisation » des imaginaires mis en débat, de telle manière que la chose remplace la parole. On évoque à ce sujet un « passage à l’acte », mais en réalité, c’est le contraire qui advient : la décision tranchée du juge, du jury, de l’auteur enfin réconcilié avec lui-même, etc. revient à arrêter le seul acte humain proprement dit - l’acte de parole -, pour le « réifier » dans une chose, (rite, site, dispositif ou objet), laquelle est censée « symboliser », c’est-à-dire valoir pour l’acte de parole qui y a abouti.
C’est en cela, d’ailleurs, que l’accomplissement d’une symbolisation sociale (au-delà des tentatives personnelles pour faire tenir une représentation des imaginaires mis en jeu) est toujours le contraire de la parole : le mot « parole », qui veut dire « rapprochement » (parabole) indique en effet l’acte humain par lequel sont rapprochées librement, activement, volontairement, des acceptions en partie indéfinies d’un projet à réaliser mais tenu pour non réel tant qu’il est en débat.
Alors que le « symbole » (le « jeté ensemble » : représentant et représenté, par exemple dans le jeton de présence à l’Assemblée du peuple) chosifie un aspect du projet : par exemple, la procédure de paroles autorisées, de conventions juridiques, son « langage », les sites et rites dans lesquels elle prend valeur (et en dehors desquels elle ne « vaut rien »), etc.
Bien entendu, sans la symbolisation (qui commence avec le système de phonèmes d’une langue, mais aussi sa codification grammaticale, stylistique et rhétorique), la parole serait très difficile (bien que non impossible : elle a bien certainement commencé avec des symbolismes très grossiers). Mais inversement, nous ne devons jamais oublier qu’une symbolisation « complète » tue la parole vive, porteuse de reconnaissance mutuelle, et qu’une parole morte ressemble plus à un algorithme -comme mécanique abstraite- qu’à un acte humain.
Pourtant, toutes les histoires conversationnelles se dirigent vers une symbolisation plus complète, c’est-à-dire vers leur propre réification. Ceci pour une raison tout aussi simple : les signifiants (que nous utilisons pour souligner les pactes de reconnaissance mutuelle que sont tous les actes de paroles) peuvent toujours être considérés en soi, comme des choses, et non comme des porteurs incertains de significations aussi variables que le sont les enjeux d’une conversation. Et, bien sûr, nous tendons tous à cette réification, car elle nous semble diminuer l’incertitude. Elle nous rassure. Nous cédons donc tous plus ou moins, à un moment ou un autre, à la tentation de prendre le mot pour la chose, et à passer à l’enjeu suivant, comme si tout était réglé, tissé, articulé, encrypté.
Or, pour utile qu’elle soit, cette chosification, ce passage dans l’implicite est un chemin qui, peu à peu, et au fil de l’ensemble des conversations tenues dans le même groupe de paroles (une culture linguistique, par exemple), se dirige vers la « sidération » de la fonction symbolique vivante. Cette dernière n’est pas, en effet, d’attacher, de coller un mot (ou une phrase) à une chose, mais, en les rapprochant parmi plusieurs possibles toujours latents, de signaler surtout l’engagement mutuel des interlocuteurs dans l’intention de réaliser ensemble librement « quelque chose ». Bref, ce que le symbole articule « comme si c’était réel », n’est rien d’autre qu’une convention et un imaginaire .
On peut alors reconnaître plusieurs étapes dans la dégra-dation des symboles usités par la parole : la métaphore proprement dite, elle-même appuyée sur un vécu réel de séparation et d’isolement, puis la métonymie, qui est inégalisation des termes de la métaphore, la catachrèse, qui est détour et surtout déguisement et refoulement d’un des termes vers une carrière « cachée », et enfin l’antinomie ou cœur du paradoxe. C’est dans cette dernière situation que le jugement tranché aggrave la difficulté en la niant abruptement, ce qui a pour effet, en général, de provoquer une régression immédiate au moment de la séparation anticipant l’hallucination métaphorante. Un cycle recommence alors, qui, s’il est situé au même niveau de généralité et d’enjeu pour un collectif analogue, répète au moins certains aspects du cycle précédent, même s’il s’en éloigne nécessairement, étant donné l’évolution des circonstances diverses.
Pourquoi et comment le paradoxe est-il toujours la fin (dans les deux sens du terme) d’une histoire conversationnelle ? Et une fin préparant le recommencement d’un cycle ? Parce que dans le paradoxe se rencontrent facialement le fondement de toute parole (le postulat de liberté souveraine de tout locuteur) et sa médiatisation la plus achevée réduisant à rien cette liberté . Parce que cette médiatisation de plus en plus poussée -éliminant la liberté d’adhérer et de participer ou non- est inéluctablement portée par le désir de chacun et de tous de réaliser enfin le but imaginaire de toute rencontre humaine.
Chaque cycle conversationnel (qui peut exister au niveau du plus grand groupe possible à tel moment de l’histoire) se dirige donc inéluctablement vers le moment où personne ne peut plus ignorer que la libre adhésion à « l’être ensemble » implique non seulement de symboliser procédures et objets, mais encore les sujets eux-mêmes dans l’acte de parole qui les dévoile. Alors ce morceau d’histoire se rapproche inconsidérément de la situation où « liberté = esclavage », ce qui est proprement intenable (comme l’a démontré la destinée des totalitarismes du XXe siècle). La forme bientôt approchante de cette devise surmontant l’entrée du camp est peut-être : « liberté = transparence de chacun dans le périoptique mondial » .
Nous sommes donc en possession des éléments principaux du problème actuel de la mondialité avancée à partir de ce constat très simple -si simple en vérité que nous avons éventuellement du mal à admettre que tout es là, sous nos yeux- : la tendance majoritaire à privilégier les solutions d’augmentation de la puissance collective correspond à une phase évoluée de la conversation orchestrale autour de la « société-monde. ».
Cette phase -au cours de laquelle aucune autre instance ne rentre plus en comparaison avec un idéal global- dépasse le simple stade d’une « métonymie » : elle est en approche d’une pure autoréférence (la société ne signifiant plus que l’humanité dans son ensemble). Celle-ci s’impose politiquement et économiquement en entraînant un déclassement d’autres catégories de collectifs, ce qui implique assez rapidement une désorientation des sujets qui y sont impliqués, et, bientôt, une négation absolue de leur liberté de s’y soustraire. Parvenue à cet état de paradoxe terminal, la société-monde peut se révéler, dans certaines circonstances, pire que le mal qu’elle combat, et, du même coup, être appelée à un renversement, après que se soient aggravés continûment les symptômes d’un ressentiment à son égard.
Il suffit d’ajouter que nous-nous trouvons engagés au seuil de cette conjoncture, pour nous demander si le moment n’est pas venu de nous tourner vers d’autres possibilités.
Cette perspective d’un «frein » de l’emportement majo-ritaire en passe de devenir infernal pour tous n’est pas en elle-même nouvelle. Ce qui est nouveau est que la situation ne comporte plus, comme par le passé, de possibilité de « fuite » loin du problème, puisque la société est elle-même devenue « monde », anthropocène. Il faut donc sans doute profiter de l’exacerbation, de l’aiguisement de nos capacités de recherche, d’innovation, de trouvailles, par l’histoire de nos dilemmes, pour redécouvrir sous sa forme présente la « faille » du paradoxe inhérent à notre condition et son expression métaphorique supportable.
C’est en ce sens que nous proposons de lire les événements actuels : non pas seulement dans une déploration des aggravations, mais plutôt en y cherchant la trace -peut-être encore fugace- de solutions convenables sans oppression ou aliénation plus grandes, et sans menace de régressions tragiques ou d’une élimination de la parole (dans la robotisation du fonctionnement, par exemple).
Disons d’emblée que c’est plutôt du côté d’une division de la société-monde en « façons de vivre » que nous envisageons un chemin de solutions politiques plausibles et négociables. Nous en avons développé ailleurs les détails concrets, et nous contenterons ici d’en saisir les indices de « faisabilité » au travers des difficultés, nodosités, ou complexités inextricables rencontrées dans l’actualité.
Pour le dire d’une phrase : ce livre explore notre réalité contemporaine à l’affût des signes d’un renversement possible de la logique d’augmentation de la puissance collective en une logique de partage des pouvoirs et de retour des libertés .
Pour cette exploration, nous avons donc besoin, outre la théorie du « paradoxe » inhérent à tout acte de parole, d’une théorie sur la temporalité s’instituant dans l’Histoire contemporaine entre divers moments de cet acte, telle qu’elle induit une sorte particulière, mais très importante, de « destinée » conversationnelle.
Le monde contemporain comme approche du moment paradoxal de la métaphore orchestrale
Notre registre est ici celui d’une analyse d’une proposition acceptée aujourd’hui -de façon explicite ou surtout implicite, délibérée ou surtout sous contrainte- par une majorité des Humains contemporains, vivant en deuxième décennie du XXIe siècle. Cette proposition, comme toutes les propositions, est une métaphore, une comparaison tenue pour juste, sinon exacte. En l’occurrence, on pourrait l’énoncer ainsi (avec de nombreuses variantes) : l’unité pacifique du genre humain (rendue nécessaire par les armes thermonucléaires et biologiques) passe par un cadre commun d’échanges matériels, tout comme la maisonnée nécessite une règle entre ses membres pour être une unité de vie soutenable.
Comme toutes les métaphores « orchestrales», celle-ci repose sur une comparaison entre le petit monde des gens et le grand monde universel. Ainsi, par exemple, de l’Oumma (la communauté des Croyants), qui se compare à Ummi (la mère), ou de la Patrie ; ainsi de « l’Heimat » germanique, du « Home Office » britannique, ou de la « grande famille humaine » qui, selon René Cassin, soutient la déclaration universelle des droits de l’Homme depuis 1948. Et comme toutes les métaphores orchestrales et toutes les métaphores en général, celle de la société-monde comme économie connaît une « destinée ». Autrement dit, elle voit son sens évoluer, se modifier avec le temps et les nombreux débats qu’elle rencontre.
En général, avant d’être oblitérée par l’Histoire des idées, des mots et des réalités, une métaphore devient métonymie puis catachrèse . Pour le dire simplement : de proposition, elle devient affirmation autoritaire, puis évidence, formule incontestable et incomparable.
Le moment métonymique est celui où nous employons le terme (par exemple « économie », ou « écologie ») pour tout ce à quoi il réfère dans l’implicite (comme le respect mutuel des membres de la maisonnée, leur intérêt commun, l’intendance, etc.) Le moment catachrétique est celui où nous avons carrément oublié que le mot renvoie à une comparaison : ainsi encore d’économie ou d’écologie, dont seuls les érudits se souviennent qu’ils désignaient quelque chose d’intérieur à la maison. Et finalement, inspirée par le refoulement catachrétique, la métaphore évolue vers sa propre négation comme proposition, pour devenir l’assertion arbitraire de « maîtres du monde » qui ne perçoivent plus cet engagement que comme unique rationalité de gestion possible.
Cette destinée est pathétique, parce qu’elle ne fait qu’exprimer la quête des Humains pour croire « dur comme fer » que ce qu’ils disent sont les choses elles-mêmes, alors qu’elles ne sont, dans tous les cas, que des projets avancés par certains intérêts ou groupes d’intérêts.
Et cette quête est pathologique parce qu’elle est inévitable dans une condition humaine totalement inféodée au paradoxe de la parole, et qui cherche toujours à en sortir par une « vision » cristallisée dans des catégories, et qui rallierait « tout le monde ».
La parole humaine (le trait culturel réservé au genre humain à la différence des langages non paroliers) a en effet ceci de particulier : elle suppose l’adhésion d’un sujet. Or, sans cette adhésion, l’accès à l’humanité est impossible ou très difficile.
Autrement dit : nous ne sommes pas libres de ne pas choisir la liberté. Notre liberté de sujets de la parole est fondée sur l’obligation absolue de parler… c’est-à-dire de nous engager librement dans l’acte de parole. A l’instant même où nous proférons la phrase : « je choisis de ne pas parler », je démontre que je ne choisis pas, puisque je dois d’abord parler pour la phrase ait un sens, voire une application pratique réelle . Mais en même temps, puisque je parle, même en me taisant, je pose bien un acte qui ne vaut que comme preuve de liberté de le faire !
L’humanité se débat dans ce paradoxe fondamental depuis les origines de la culture parolière et ceci dans un emportement constant, parfois tragique, pour une raison simple : sans position de sujet de la parole, je ne peux pas être reconnu par les semblables, et si je ne suis pas reconnu, je meurs de détresse. C’est exclusivement pour être reconnus -à la place du sujet de la parole, et dans une extériorité symbolique à nos corps - que nous parlons, et cela interminablement, au long de nos vies, et d’une vie à l’autre. Et nous parlons ainsi -en proposant des métaphores à l’agrément collectif- pour échapper au paradoxe intime de la parole… en le reconduisant à chaque moment.
La métaphore -et celle qui est la plus partagée- nous sert à croire échapper au paradoxe culturel fondamental. A y croire un moment, un temps, jusqu’à ce que son effet d’illusion s’estompe, ce qui arrive toujours à plus ou moins long terme.
La métaphore est un énoncé propositionnel dont l’inéluc-table transformation est due aux vagues d’objections qu’il reçoit progressivement (notamment de la part de métaphores concurrentes), et qui dessine généralement sa destinée en direction d’une catachrèse, puis d’une assertion dure, unaire, c’est-à-dire sans alternative, sans double même occulte, correspondant souvent à une sorte de ralliement résigné mais très majoritaire. Alors, la métaphore « transformée » se pense dans un état de singularité, de concrétude et de solidité achevée. Erreur : c’est le moment où elle devient le plus fragile, le plus cassante, la plus dépendante.
C’est ce qui commence à arriver dans la période con-temporaine à la métaphore géo-éco-démo-cratique. Le triomphe mondial du libéralisme depuis 1989 a correspondu à la fixation catachrétique de cette idée, et 25 ans plus tard nous vivons le début de sa désagrégation comme outil absolu de lecture du réel.
Elle se désagrège en particulier sous les coups de méta-phores en compétition, dont certaines, très classiques, comme la haine des cultures différentes, la nostalgie des anciennes métaphores salvatrices -comme les religions- ou simplement le progrès des idéaux de domination et d’exploitation sous le paravent «égalitaire » que serait la « market democracy ».
Ce livre se situe donc d’abord en un point du parcours de la métaphore géo-éco-démocratique : celui où nous commençons à soupçonner qu’elle ne nous exempte pas du paradoxe fondamental, de celui qui nous confronte à notre déréliction mentale, à notre non-reconnaissance par autrui, à notre isolement terrifiant au cœur même du monde des Humains, et donc à la recherche désespérée d’autres « histoires crédibles ».
Ce travail est l’analyse de ce phénomène : l’insinuation d’un doute effrayant au cœur des certitudes les plus ancrées à propos de l’universalité économique/écologique et sociétale, les plus débarrassées de toute contestation, de toute critique. Et c’est du même coup la pose d’une pierre d’attente : celle de l’émergence d’une nouvelle métaphore crédible, au moins pour un temps indéfini par avance.
Si une discipline anthropologique était concernée par notre propos et notre étude, ce serait celle d’une « psycho-histoire », dont nous avons établi quelques linéaments il y a déjà 15 ans dans notre «Entre Esprit et Corps, la culture contre le suicide collectif » . Nous y mettions en évidence les lentes -ou rapides- embardées que les cultures historiales tracent entre des figures métaphoriques opposées, comme si la perte de croyance en l’une d’elle tendait à nous pousser vers l’autre extrémité « logique ».
Si cette hypothèse n’est pas seulement poétique, nous pourrions soutenir qu’après un Esprit-Monde (au fond bien annoncé par Hegel), viendrait une Pluralité de Corps. Pas une multitude -qui se résorbe trop facilement dans un Esprit global, comme une foule moutonne uniformément dans un Mall unique et massif - mais une pluralité de quelques grandes dimensions humaines irréductibles.
Nous parlerons très peu ici de la métaphore pluraliste que nous développons ailleurs sous toutes ses facettes , comme solution, mais nous voudrions soumettre au lecteur la proposition détaillée selon laquelle les symptômes du mal être contemporain convergent pour pointer la transformation des métaphores démocratique, économique, écologique , en système de prisons des peuples, et du même coup pour appeler à des imaginaires qui, bien qu’appuyés sur lui pour émerger, lui échappent.
 Commander des livres de Denis Duclos (études et essais)
Commander des livres de Denis Duclos (études et essais)

 CRISE DU CAPITALISME ET CONSOLIDATION DU SYSTEME-MONDE
CRISE DU CAPITALISME ET CONSOLIDATION DU SYSTEME-MONDE